Malgré la collision Inde-Asie, le sud du Tibet se distend
Certaines régions soumises à une convergence de plaques, et donc à une compression, présentent paradoxalement des marques d'extension sous la forme de fossés d'effondrement (graben) abaissés par le fonctionnement de failles. L'exemple le plus frappant est celui du sud du plateau tibétain, juste au nord de la chaîne himalayenne qui présente plusieurs fossés de direction nord-sud. L'interprétation de cette extension perpendiculaire à la convergence des plaques indienne et eurasiatique a fait l'objet de plusieurs hypothèses. En retracant la chronologie des événements pour un fossé situé au sud du plateau tibétain, des chercheurs francais, chinois et des Etats-Unis remettent en cause l'association temporelle entre failles normales et volcanisme impliquée par le modèle de délamination lithosphèrique, pour privilégier un modèle d'ajustement des contraintes en limite de plaque.
Dans un contexte de collision continentale, après un épisode d'épaississement de la lithosphère, certains domaines orogéniques voient se développer des failles normales et une extension alors que la convergence est toujours active. Un exemple marquant est celui de la bordure sud du plateau tibétain, juste au nord de la chaîne himalayenne qui présentent plusieurs fossés d'effondrement de direction nord-sud, marquant une extension est-ouest alors que la convergence Inde-Asie de direction nord-sud se poursuit. Ces fossés ont été décrits pour la première fois en 1986 par des chercheurs francais, mais leur interprétation est toujours sujette à débat.
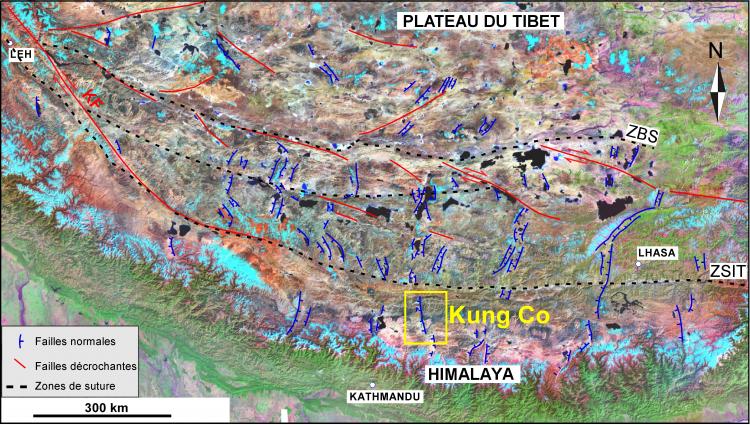
Déterminer l'époque à laquelle les failles normales responsables de la formation de ces fossés ont commencé à devenir actives est essentiel pour en comprendre l'origine ; de même qu'il est important de déterminer s'il y a eu plusieurs phases d'activité et de comparer leur chronologie avec celles d'autres événements comme la mise en place de massifs granitiques dans la chaîne Himalayenne entre 9 et 27 millions d'années ou du volcanisme du plateau tibétain daté de 8 à 25 millions d'années. Les granites himalayens sont attribués à la fusion de la lithosphère continentale du fait de son épaississement par la collision Inde Asie, le volcanisme tibétain est attribué à la fusion du manteau. Si l'apparition et le fonctionnement des failles normales sont concomitantes des événements magmatiques, les modèles de la première catégorie seront confortés, si elles sont postérieures ce seront plutôt les modèles de la seconde catégorie qui le seront.
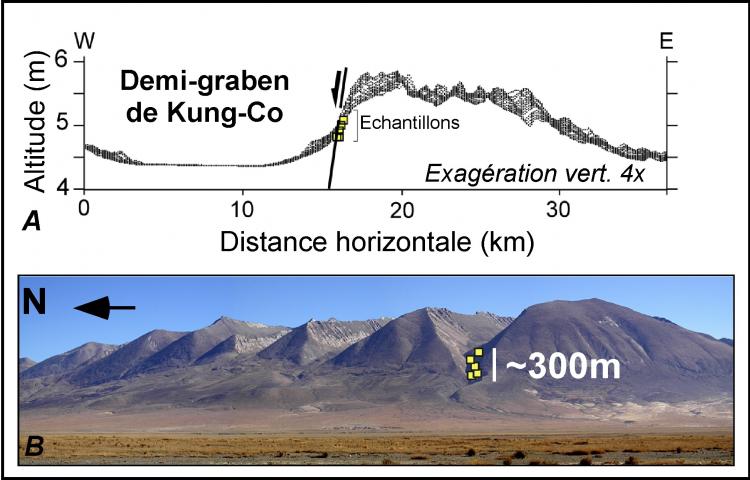
Les roches qui constituent le bloc qui borde le fossé sont des roches sédimentaires déposées au Mésozoïque (250 à 60 Ma) dans l'ancien océan Téthys. Un massif granitique, comme il en existe ailleurs dans la chaîne Himalayenne, s'est mis en place tardivement dans ces roches, les métamorphisant à son contact. Les auteurs de l'article ont analysé des échantillons provenant de ce granite pour en déterminer l'âge de mise en place et retracer l'histoire de son refroidissement. Cette histoire permet d'établir l'âge des événements tectoniques et thermiques ayant affecté la région dont l'initiation de la faille normale. Pour cela, ils ont combiné plusieurs méthodes géochronologiques sur différents minéraux : - mesure des isotopes de l'Uranium et du Plomb dans les zircons afin de déterminer l'âge et la température de cristallisation du massif ; - mesure des isotopes de l'Argon dans les micas afin de préciser le refroidissement entre 450 et 250°C ; - mesure des isotopes de l'Uranium et du Thorium ainsi que de la teneur en Hélium dans les zircons et apatites afin de préciser le refroidissement entre 200 et 70°C.
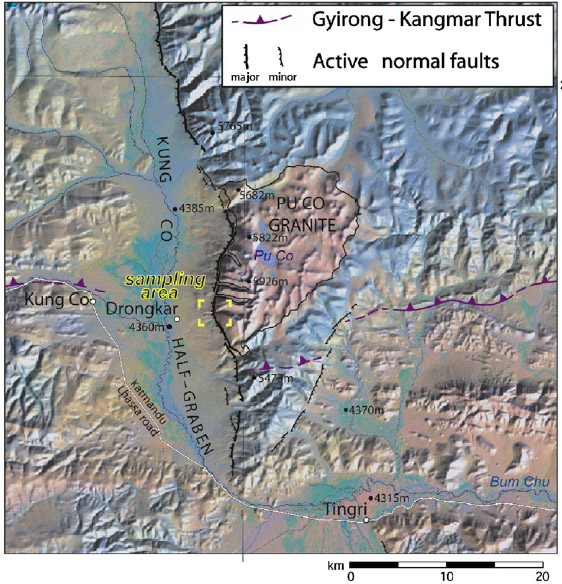
Sources
Post 4 Ma initiation of normal faulting in southern Tibet. Constraints from the Kung Co half graben
Earth and Planetary Science Letters 256 (2007) 233–243
G. Mahéo, P.H. Leloup, F. Valli, R. Lacassin, N. Arnaud, J.-L. Paquette,A. Fernandez, L. Haibing, K.A. Farley, P. Tapponnier
Division of Geological and Planetary Sciences, California Institute of Technology, USA
Laboratoire de Sciences de la Terre, CNRS-Université de Lyon
Institut de Physique du Globe de Paris, CNRS-Université Denis Diderot
I S T E E M - U S T L, CNRS-Université de Montpellier
Laboratoire Magmas et Volcans, CNRS-Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand
Institute of Geology, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing
![Carte tectonique du Sud Tibet sur fond de mosaïque Landsat.
ZSB : zone de suture de Bangong, ZSIT: zone de suture de l'Indus Tsangpo. Le faille normales délimitent des fossés d'effondrement.
© Mahéo et al.[...] Carte tectonique du Sud Tibet sur fond de mosaïque Landsat.
ZSB : zone de suture de Bangong, ZSIT: zone de suture de l'Indus Tsangpo. Le faille normales délimitent des fossés d'effondrement.
© Mahéo et al.[...]](/sites/institut_insu/files/styles/top_left/public/gallery_image/b2033.jpg?itok=5FV8YGhP)