Le séisme de Concepcion, Chili, du 27 février 2010
Depuis les années 1980 les chercheurs de l'IPGP (INSU-CNRS, Paris Diderot) et du Laboratoire de géologie (ENS, INSU-CNRS) étudient l'activité sismotectonique du Chili. Dans le cadre de coopérations franco-chiliennes, avec le soutien de l'Institut National des Sciences de l'Univers, des réseaux sismologiques et de mesures de déformations GPS, notamment, ont été installés de longue date dans des zones identifiées comme des lacunes sismiques, c'est-à-dire susceptibles de rompre avec une forte magnitude. Pour intensifier ces études, le laboratoire international Montessus de Ballore (1) a été crée en 2006 entre le CNRS-INSU et l'Université du Chili à Santiago. C'est une de ces lacunes qui a été affectée par le séisme du 27 février. Les responsables français du laboratoire font une première analyse du séisme.
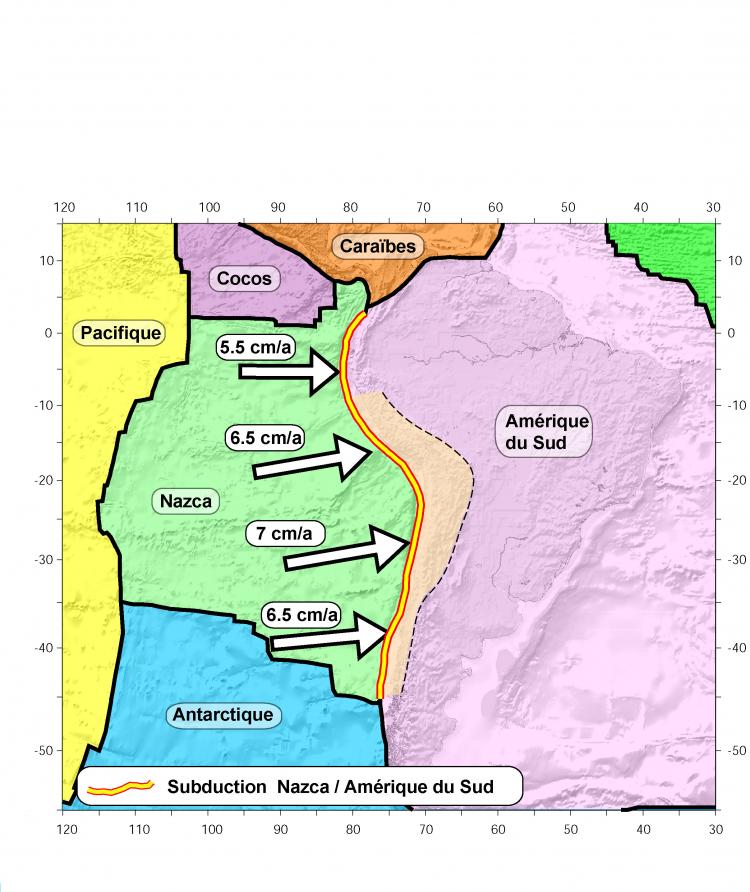
La sismicité du Chili
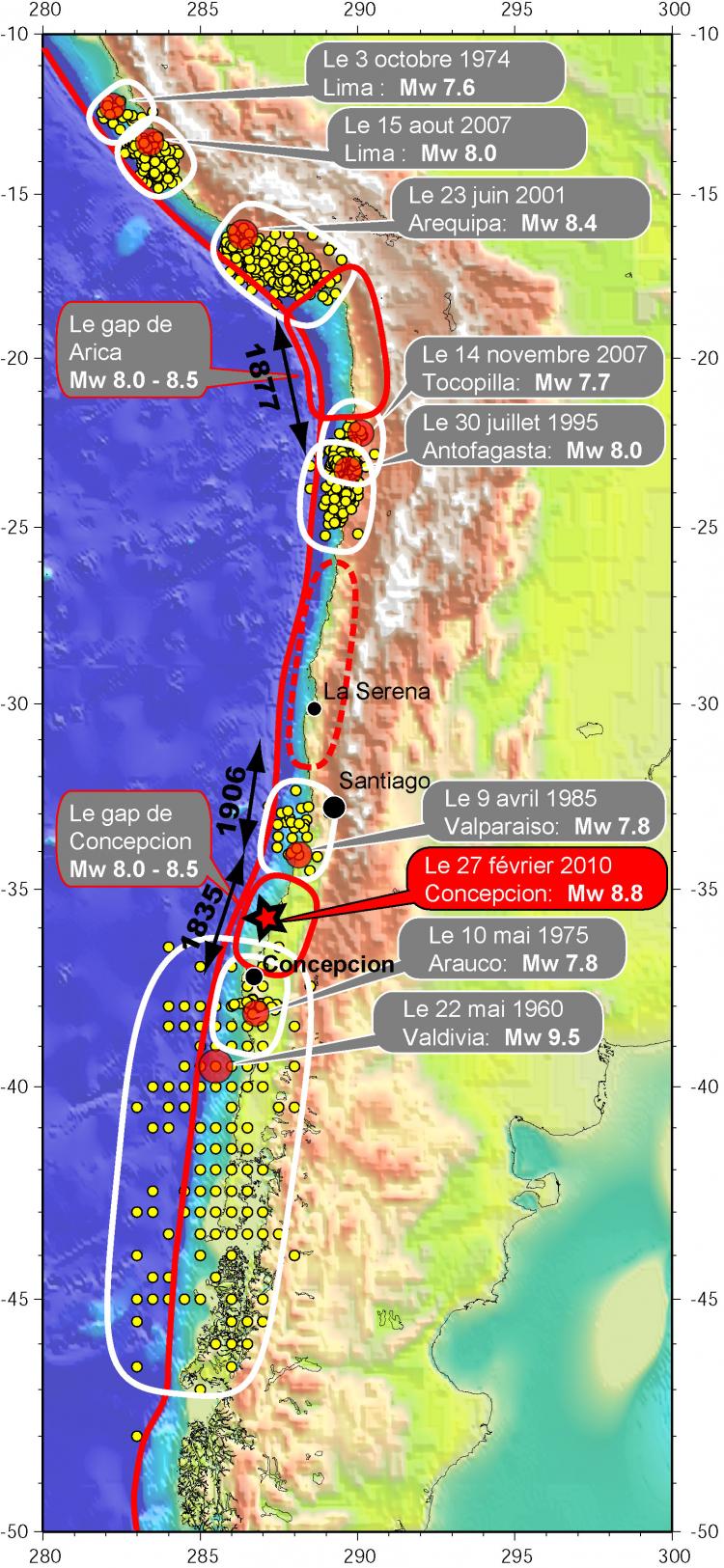
A partir des études qu'ils mènent au Chili depuis plusieurs décennies les chercheurs de l'IPGP et de l'ENS avaient identifié dès le début des années 1990 deux lacunes sismiques au Nord et au Centre/sud du Chili qui leurs semblaient proches de la rupture (les zones entourées en rouge de la figure). La lacune d'Arica au Nord, siège d'un séisme géant en 1877 et qui a commencé à rompre en partie lors du séisme de Tocopilla en 2007 ; et précisément la lacune de Concepcion, siège d'un séisme de magnitude largement supérieure à 8 en 1835, décrit par Darwin. Cette lacune était bordée au Sud par la rupture géante de 1960 et au Nord par les séismes de Valparaiso en 1906 et 1985. Dans cette région, leurs mesures GPS montraient une accumulation «normale » de la déformation, sans aucun glissement a-sismique. Ainsi, depuis 175 ans à 7 cm/an, c'est au moins 12 m de déformation qui s'étaient accumulés sur ce segment de 400km de long. En conséquence, dans un article récent à PEPI (3), ces chercheurs réunis au sein du Laboratoire International Associé (LIA) «Montessus de Ballore» avaient évoqué la très forte probabilité d'une rupture imminente dans cette région, de magnitude entre 8 et 8.5.
Le séisme du 27 février
L'épicentre du séisme du 27 février est localisé au centre de la lacune de Concepcion. Sa profondeur (environ 35 km) et son mécanisme chevauchant ne laissent aucun doute sur le fait que c'est un séisme de subduction typique, sur l'interface de contact entre les deux plaques. La répartition des répliques, dont les plus fortes ont atteint une magnitude de 6,9, indique que la rupture s'est propagée à la fois vers le Sud et vers le Nord, de manière à rompre la totalité du segment de la lacune de Concepcion, et même au delà vers le Nord, puisqu'elle semble avoir franchi la baie de San Antonio et avoir repris, au moins en partie, le segment de Valparaiso qui avait rompu en 1906 et 1985. C'est probablement la reprise de ce segment avec la lacune principale qui explique la très forte magnitude de ce séisme.
La profondeur du séisme (35 à 40 km) peut expliquer la magnitude somme toute modérée du Tsunami qui a suivi : la rupture ayant dû arriver faiblement en surface, le déplacement du fond de l'océan a dû atteindre 5 mètres et peut être un peu plus localement, ce qui s'explique par une règle empirique toute simple qui veut que la hauteur maximum atteinte par l'eau soit de l'ordre du glissement maximum sur la faille, estimé à 6-8 m ici. Par contre, cela place l'hypocentre juste sous la côte (plutôt que plus loin au large), ce qui peut avoir engendré des destructions importantes à sa proximité, et donc en particulier aux alentours de la ville de Cauquennes et de Constitucion.
La distribution des premières répliques pose un problème. En effet, elles semblent indiquer une rupture longue, de l'ordre de 600km de long, ce qui expliquerait la magnitude élevée de 8.8. Par contre, cela parait peu compatible avec les premières inversions de la source sismique réalisée par G. Hayes (NEIC) qui indiquent une longueur de rupture de l'ordre de 350km seulement, exactement localisée dans la lacune de 1835.
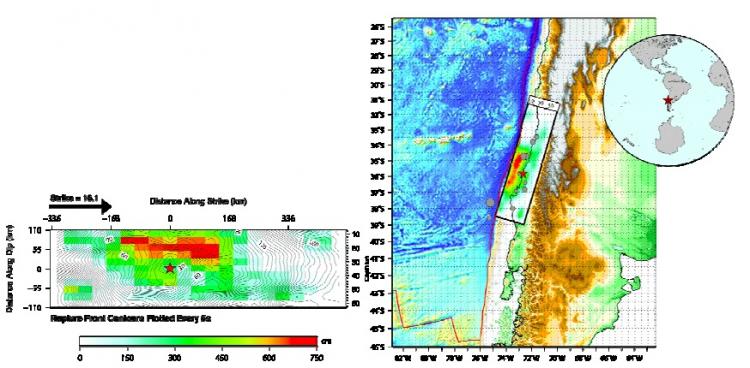
Les nouvelles questions
Ce séisme survenu, de nouvelles questions se posent :
- Le séisme a-t-il relâché toute la déformation accumulée depuis au moins 175 ans?
Si oui, les répliques devraient diminuer progressivement en fréquence et en intensité. Si non, il faut s'attendre à d'autres séismes très forts dans la même région, désormais fragilisée par cette première rupture.
- L'augmentation des contraintes aux bouts de cette rupture va-t-elle déclencher d'autres ruptures, au Nord et au Sud?
Au Sud, cela semble peu probable : c'était le lieu du séisme géant de 1960 qui n'avait pas encore commencé à ré-accumuler de la déformation depuis. Au Nord, c'est possible, les séismes de Valparaiso (1985), La Serena (1943) et Vallenar (1922) n'ayant probablement relâché qu'une partie des contraintes accumulées depuis le séisme géant de cette région en 1730.
- Pourquoi les répliques montrent-elles une rupture s'étalant sur 600 km, alors que les premières inversions de la source sismique semble montrer une rupture de seulement 350km, s'intégrant bien dans la lacune connue de 1835 ?
Y a-t-il eu séisme lent au Nord ? Tous ces séismes sont-ils des répliques?
- Pourquoi y a-t-il des répliques au Sud de la péninsule d'Aurauco ?
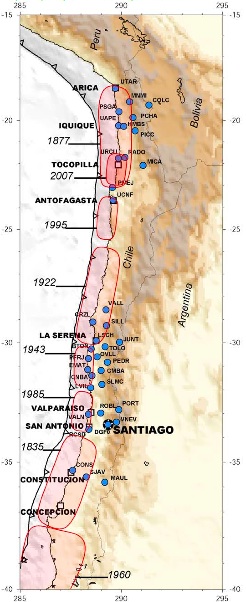
L'équipe du laboratoire de Géologie de l'ENS (INSU-CNRS, ENS) et de l'Institut de physique du globe de Paris (INSU-CNRS, Paris Diderot)(4), en coopération avec des instituts et agences Chiliennes (5) effectue des mesures géodésiques (GPS) et sismologiques depuis 1996 dans la région. Dans le cadre du laboratoire international associé « Montessus de Ballore », le réseau de bornes géodésiques sera remesuré afin de quantifier précisément la déformation de la croûte générée par ce séisme, et effectuer la maintenance des stations permanentes dont certaines (en particulier celles de Constitucion et San Javier) ont sans doute souffert. L'équipe participera également à l'installation de sismographes destinés à localiser précisément les répliques, en coordination avec le GFZ-Potsdam allemand.
D'autres laboratoires travaillent également dans cette région depuis 1990, en particulier l'EOST de Strasbourg (INSU-CNRS, Université de Strasbourg) et Géoazur (INSU-CNRS, IRD, Université de Nice). Les diverses équipes concernées examinent leurs actions possible au sein de la cellule d'intervention postsismique de l'INSU.
Enfin, l'ensemble de la subduction chilienne est également, un "site instrumenté" labélisé par l'INSU, qui reconnait ainsi l'importance des recherches sur ce sujet dans cette région du monde et les soutient tout particulièrement.
Pour en savoir plus
Notes
- Le LIA « Montessus de Ballore » est une structure internationale consécutive à un accord signé en 2006 entre l'université du Chili à Santiago et le CNRS/INSU. Il comprend un certain nombre de chercheurs Chiliens et Français, et son objectif principal est l'étude de la sismo-tectonique du Chili.
- (localisation USGS/NEIC, CSEM/EMSC)
- Interseismic strain accumulation measured by GPS in the seismic gap between Constitucion and Concepcion in ChileRuegg, J.C., A. Rudloff, C. Vigny, R. Madariaga, J.B. DeChabalier, J.Campos, E. Kausel, S. Barrientos, D. DimitrovPEPI, Vol 175, issue 1-2, June, 10.1016/j.pepi.2008.02.015, 2009.
- Le laboratoire de Géologie de l'ENS et l'Institut de physique du globe de paris, UMR 8538 et 7154 du CNRS : P. Bernard, A . Fuenzalida, M. Lancieri, A. Lorme, R. Madariaga, M. Métois, S. Morvan, J.C. Ruegg, S. Ruiz, A. Socquet, J.P. Vilotte, C. Vigny
- L'Université du Chili à Santiago et l'Université de Concepcion : J.C. Baez, S. Barrientos, K. Bataille, J. Campos, S. Peyrat.
![La tectonique des plaques de la région. Le trait épais rouge/jaune montre la subduction de la plaque Nazca sous la plaque Amérique du Sud ; le trait en pointillé montre la zone de déformation Andine à l'intérieur de la plaque. Les flèches montrent la direction et la vitesse de convergence déterminée par GPS.
© Géologie de l'ENS (INSU-CNRS, ENS)[...] La tectonique des plaques de la région. Le trait épais rouge/jaune montre la subduction de la plaque Nazca sous la plaque Amérique du Sud ; le trait en pointillé montre la zone de déformation Andine à l'intérieur de la plaque. Les flèches montrent la direction et la vitesse de convergence déterminée par GPS.
© Géologie de l'ENS (INSU-CNRS, ENS)[...]](/sites/institut_insu/files/styles/top_left/public/gallery_image/b3813.jpg?itok=03p4SnwH)